Handicap et sexualités
Nous parlons de sexualités au pluriel, parce que parler de LA sexualité n’a pas beaucoup de sens : il existe non seulement une grande variété de sexualités, mais aussi une multitude de situations de handicap.
Une loi française de 2005 reconnaît “aux personnes en situation de handicap le droit au respect de leur vie privée et à l’exercice de leur autonomie, y compris dans le domaine de la sexualité”.
La loi mentionne 5 types de handicaps différents :
moteur (par exemple, une personne qui est paraplégique) ;
sensoriel (telle que la déficience auditive) ;
mental (défini par une déficience du développement intellectuel) ;
psychique (le trouble bipolaire, par exemple, est considéré comme un handicap psychique) ;
cognitif (troubles de l’attention, troubles de la mémoire, dyslexie…).
Les handicaps ont, selon leur nature et leur degré, plus ou moins de conséquences sur la vie sexuelle et affective. La sexualité ne se résume pas à des réactions génitales et à des actions physiques : elle mobilise tout le corps, mais aussi les pensées, l’imagination… Même une personne avec un handicap moteur, qui n’aurait pas de sensations des épaules aux doigts de pied, peut avoir une vie affective et une sexualité épanouie si elle le souhaite. De même, une personne déficiente intellectuellement doit avoir accès à des moyens de s’exprimer, de s’informer, et de se protéger des risques.
Il y a moins de stigmatisations ou de réticences face à la sexualité des personnes concernées par les autres types de handicap (sensoriel, psychique et cognitif), mais leur sexualité peut également être affectée par leur trouble ou condition particulière.
Avec les outils et les espaces de parole adaptés, les notions de consentement, de désir, de plaisir, de couple, de parentalité, etc, peuvent être comprises et utilisées par toustes. Des associations et des institutions prennent très bien en compte cette question. On vous invite à consulter le programme Handicap & Alors du Planning familial.
Le droit à l’intimité
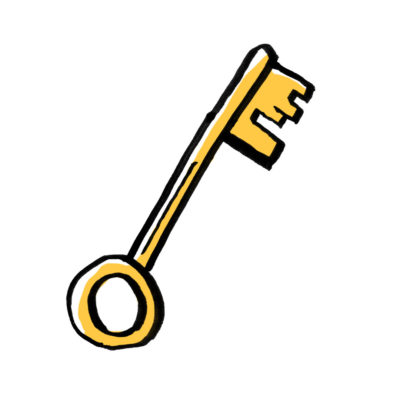 Chez elles ou en institution, les personnes en situation de handicap sont souvent confrontées à la problématique de la dépendance à autrui. En effet, le handicap peut empêcher de faire de nombreuses actions du quotidien, ou bien mettre en danger la personne elle-même ou son entourage.
Chez elles ou en institution, les personnes en situation de handicap sont souvent confrontées à la problématique de la dépendance à autrui. En effet, le handicap peut empêcher de faire de nombreuses actions du quotidien, ou bien mettre en danger la personne elle-même ou son entourage.
Une personne en situation de handicap a parfois besoin d’accompagnement dans tous les actes de la vie quotidienne. Il peut donc être difficile d’avoir un espace à soi, où on est libre d’explorer son propre corps ou une sexualité avec partenaire.
De plus, les handicaps ne sont pas tous perçus de la même façon au sein de la société. Ainsi, les personnes souffrant d’un handicap mental sont souvent infantilisées par les personnes dites “valides” qui les accompagnent. Ces dernières ont du mal à voir ou à accepter leur besoin légitime d’une vie sexuelle et affective. Souvent, parce qu’elles veulent les protéger de violences à tout prix. Fréquemment aussi parce qu’elles refusent tout simplement d’être confrontées à la question de la sexualité, qui reste encore taboue pour beaucoup.
Dans les établissements spécialisés, la sexualité des personnes en situation de handicap est encore quasi indicible, notamment lorsqu’elle concerne des personnes vivant dans la même structure et qui souhaitent avoir ensemble des moments d’intimité, ou avoir accès à de l’information, de la contraception, etc.
Handicaps et violence
D’après un rapport de l’ONU de 2019 (lien), 80% des femmes en situation de handicap ont déjà subi des violences dans le monde. Elles ont aussi deux fois plus de risque qu’une femme dite “valide” d’être victime de violence au sein du couple.

Cela peut s’expliquer par plusieurs facteurs : les personnes en situation de handicap ont moins accès à une éducation à la sexualité au cours de leur vie et donc peuvent avoir plus de difficultés à déterminer ce qui constitue une violence ; elles peuvent se retrouver davantage dépendantes financièrement (entre autres) de l’agresseur·se ; elle sont considérées comme moins apte à prendre des décisions et à comprendre ce qui les affecte, donc leur parole est (encore) moins écoutée et crue que les personnes dites “valides” ; elles ont des difficultés à se déplacer pour se mettre en sécurité, ou des difficultés à s’exprimer et donc à se faire comprendre par quelqu’un·e qui pourrait aider…
Par ailleurs, un·e agresseur·se repère les personnes vulnérables et utilise ces vulnérabilités pour installer leur emprise… Malheureusement, de nombreuses personnes en situation de handicap correspondent à ce profil.
Que faire ? Comme souvent, la réponse est facile à dire, mais difficile à mettre en place par manque de moyens financiers et de personnel qualifié : former les professionnel·le·s de santé et les aidant·e·s. Ces derniers pourront alors mieux informer les personnes sur leurs droits, mais aussi mieux repérer les signaux d’alertes et savoir comment agir.